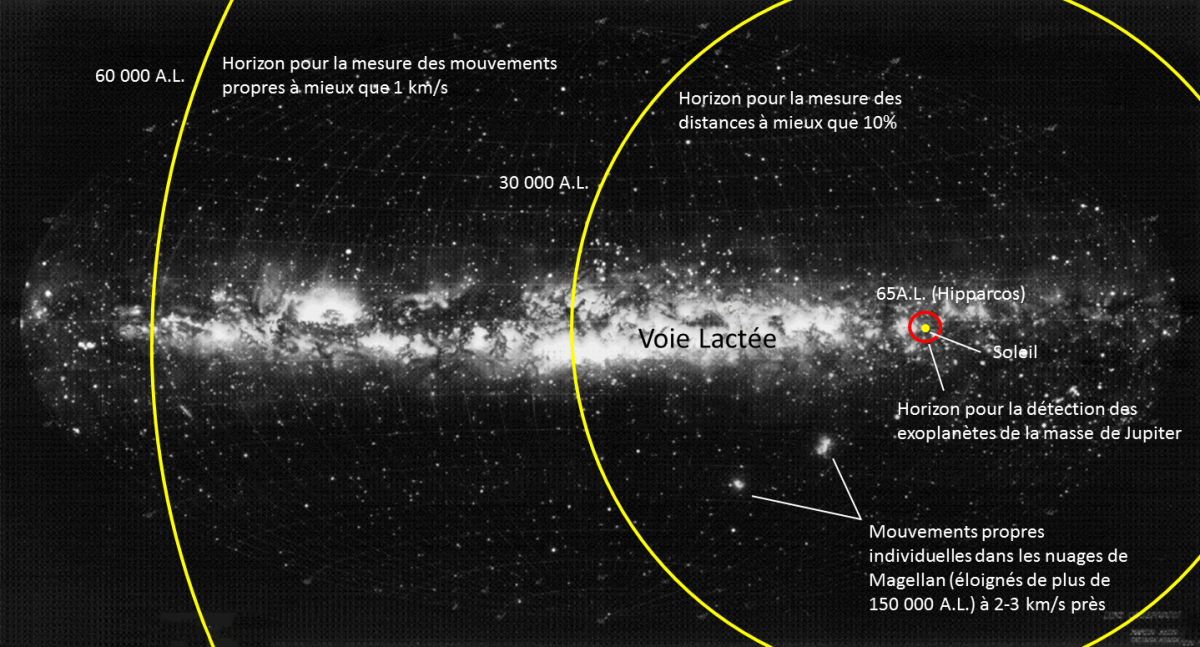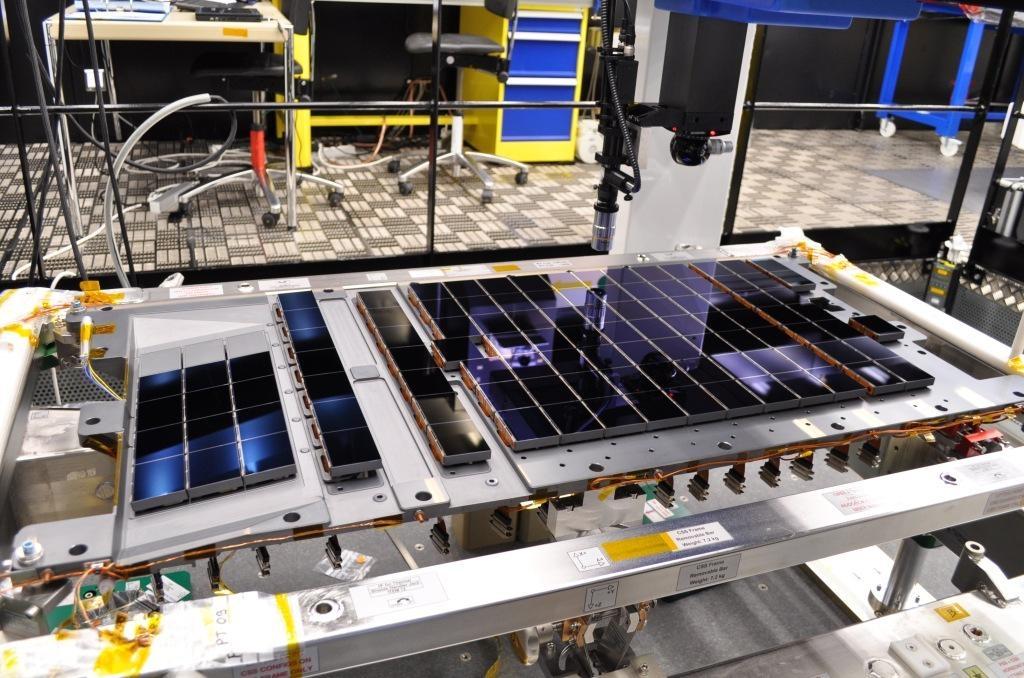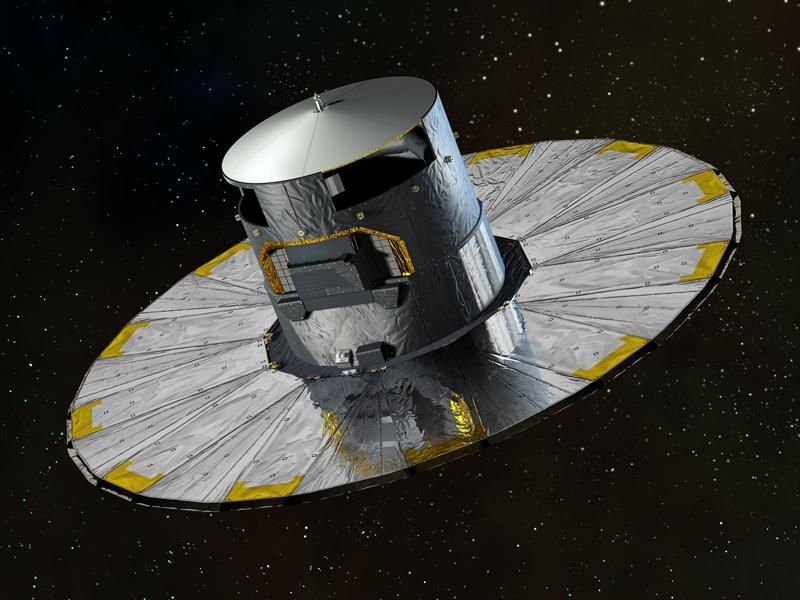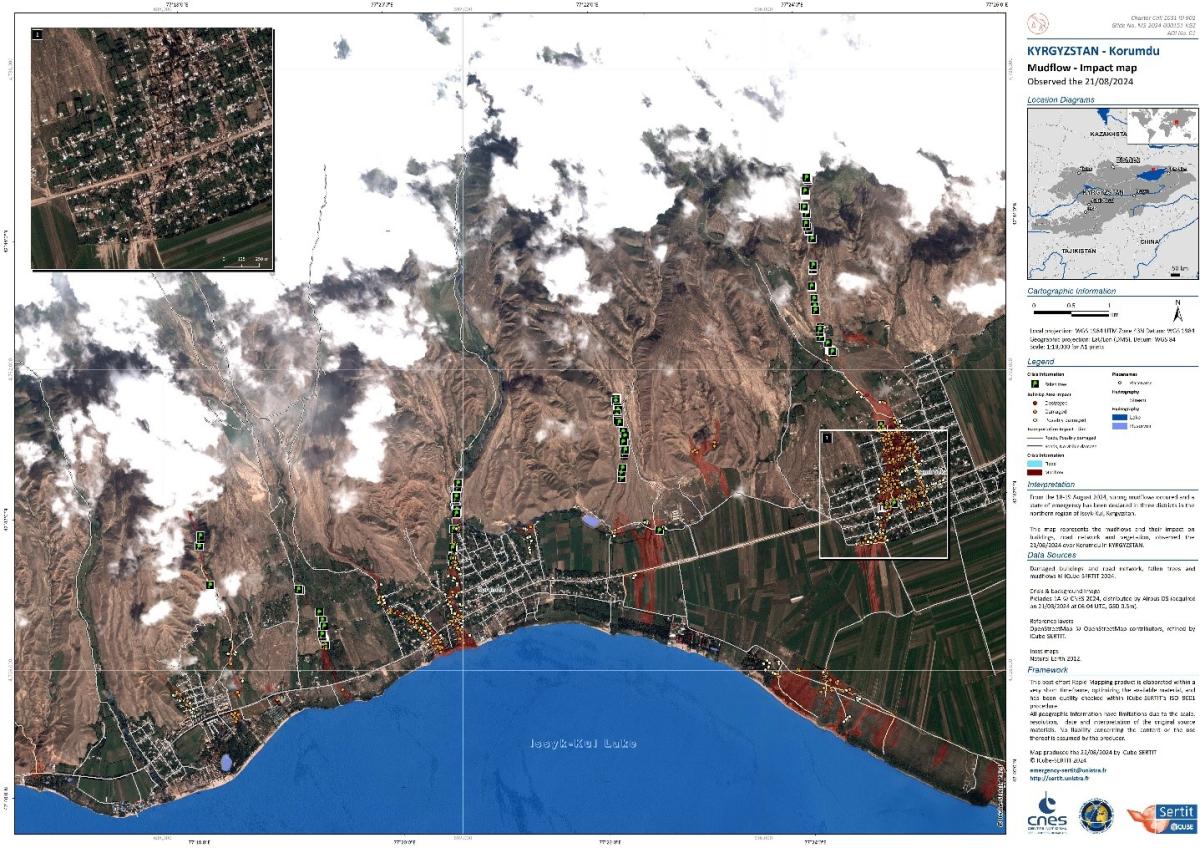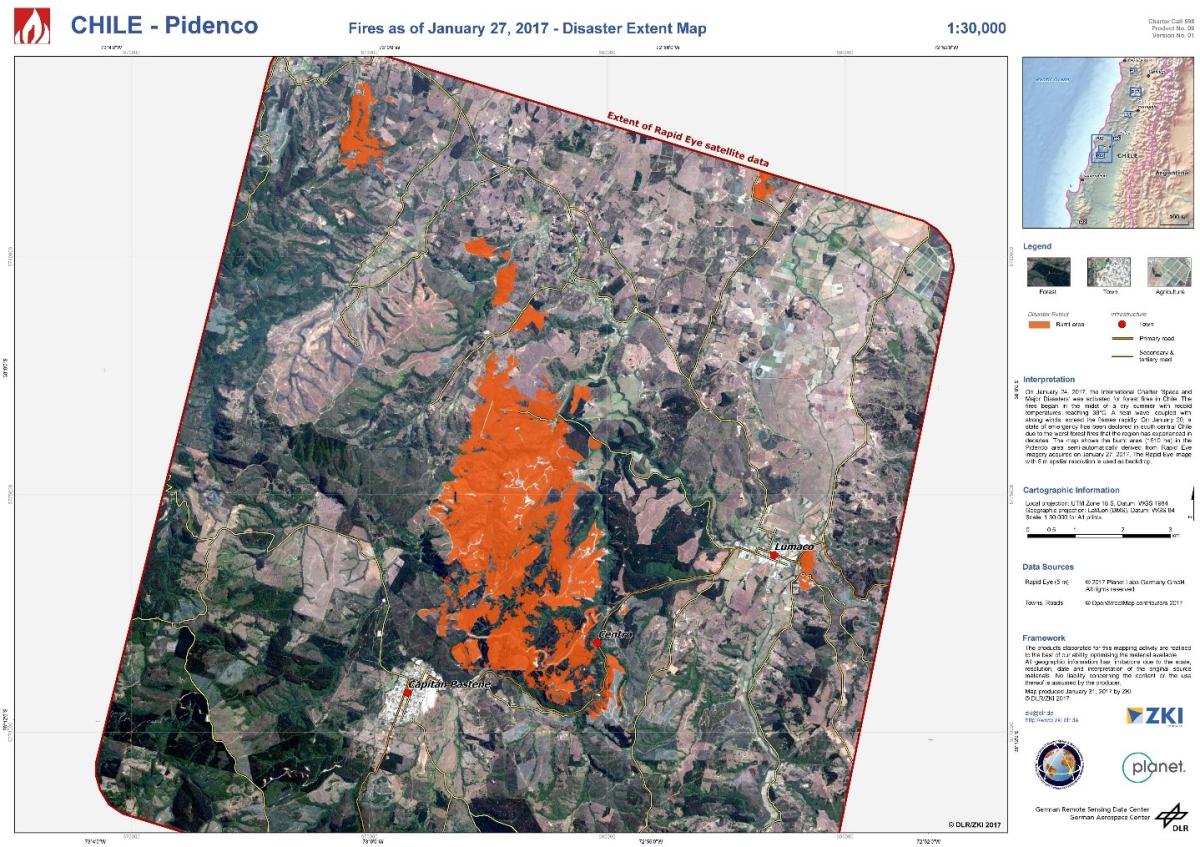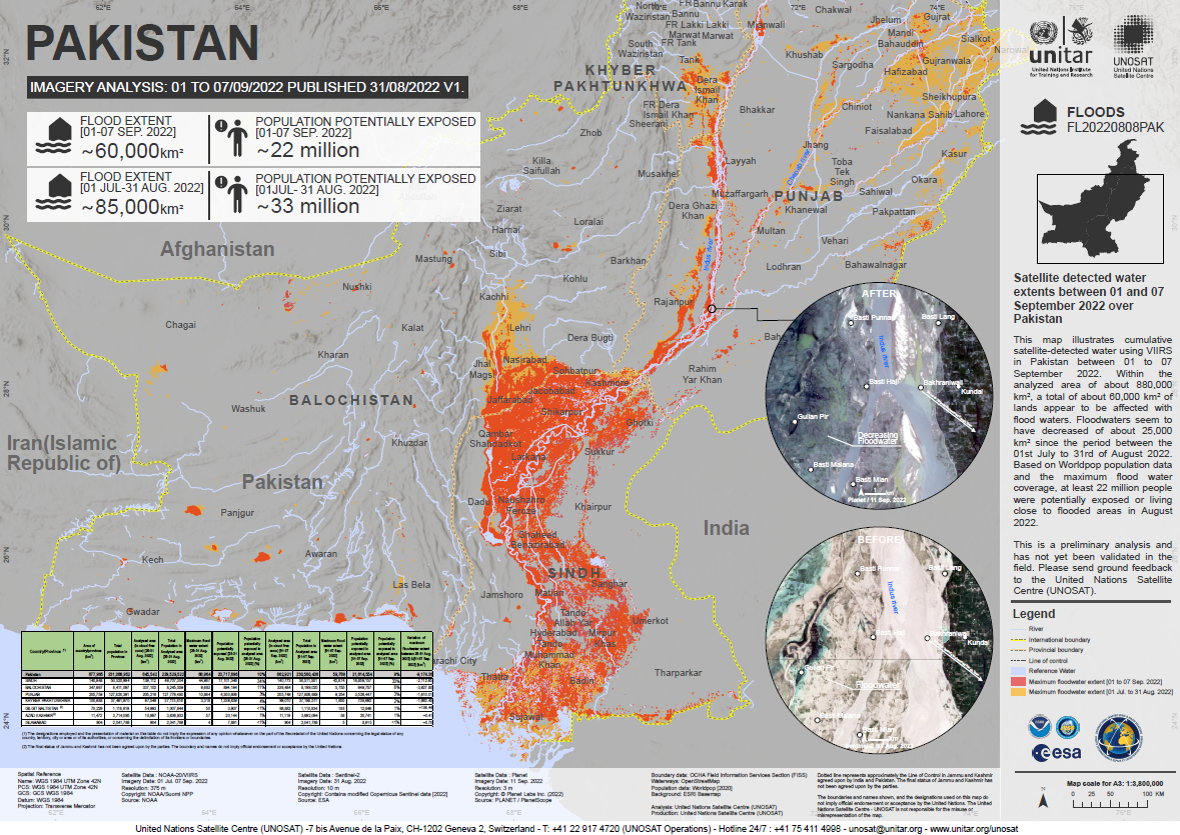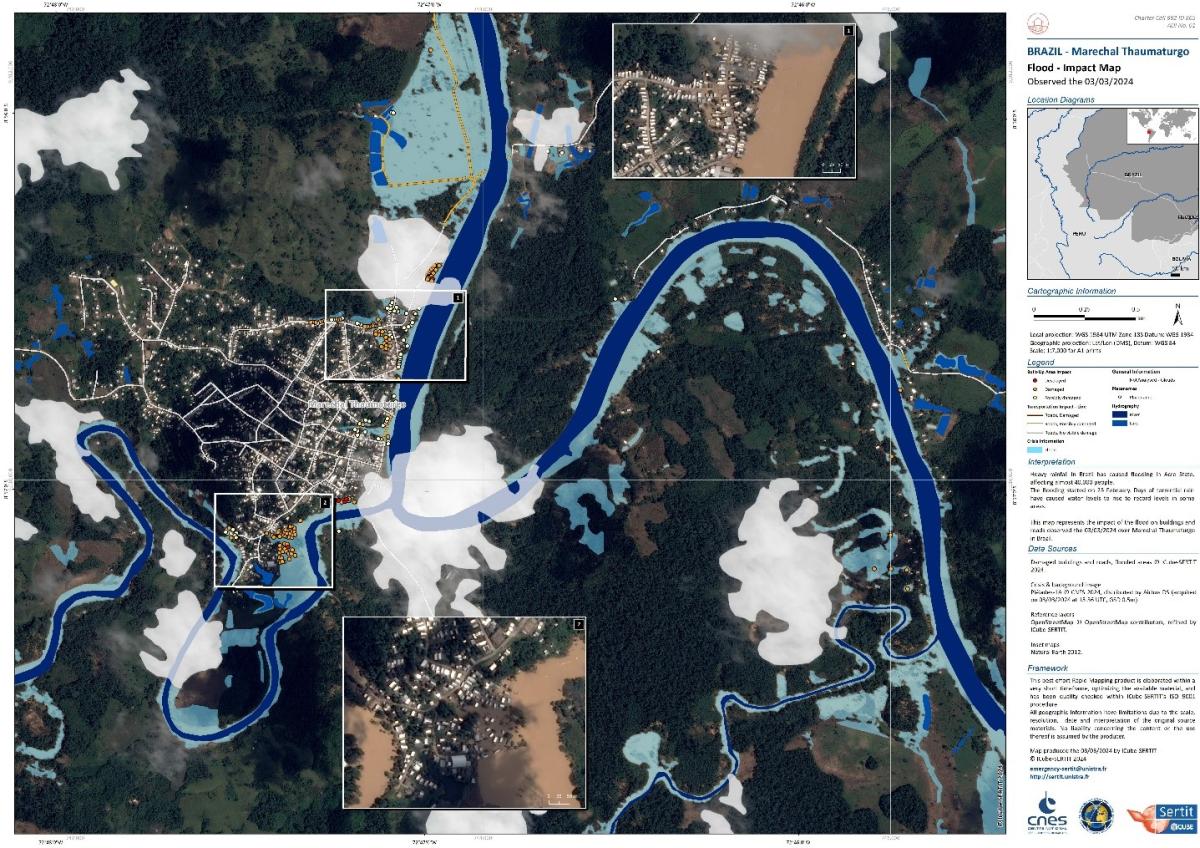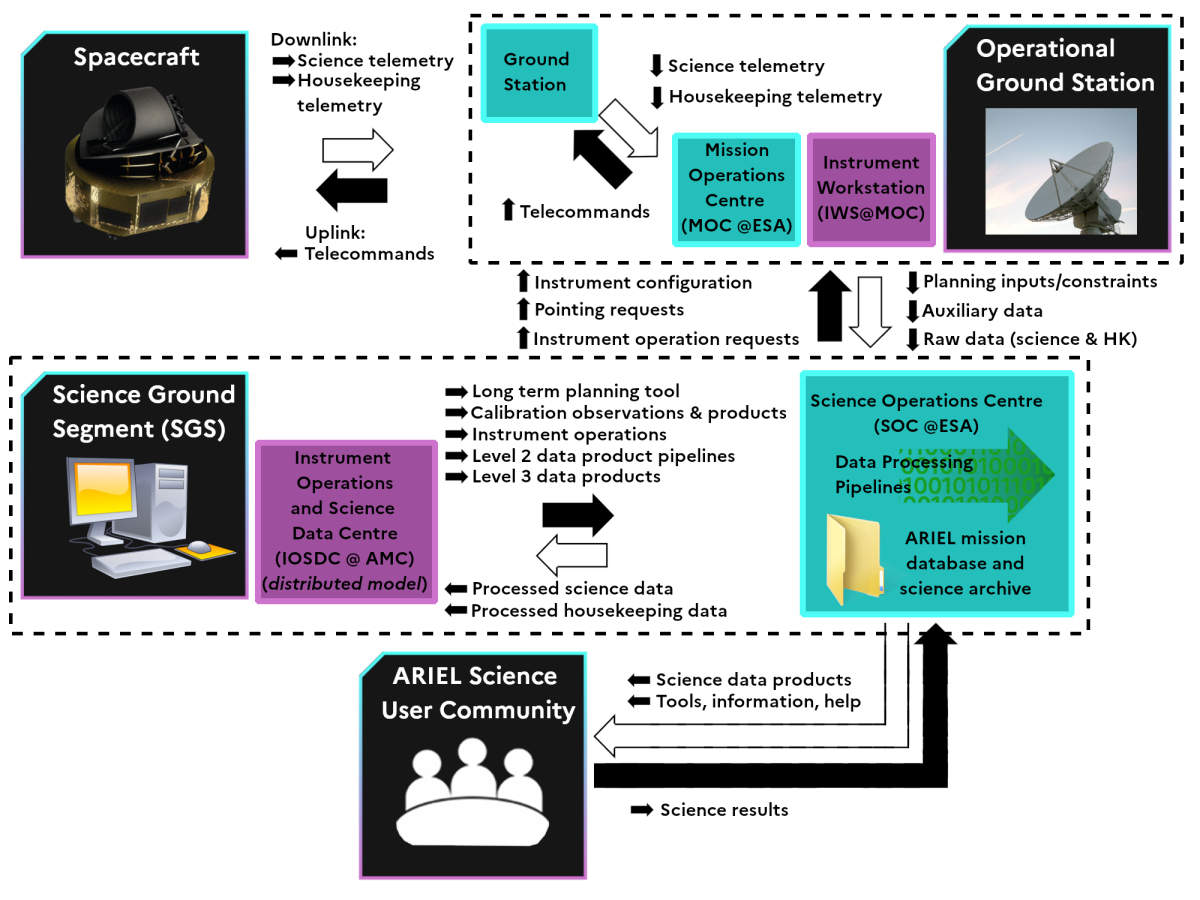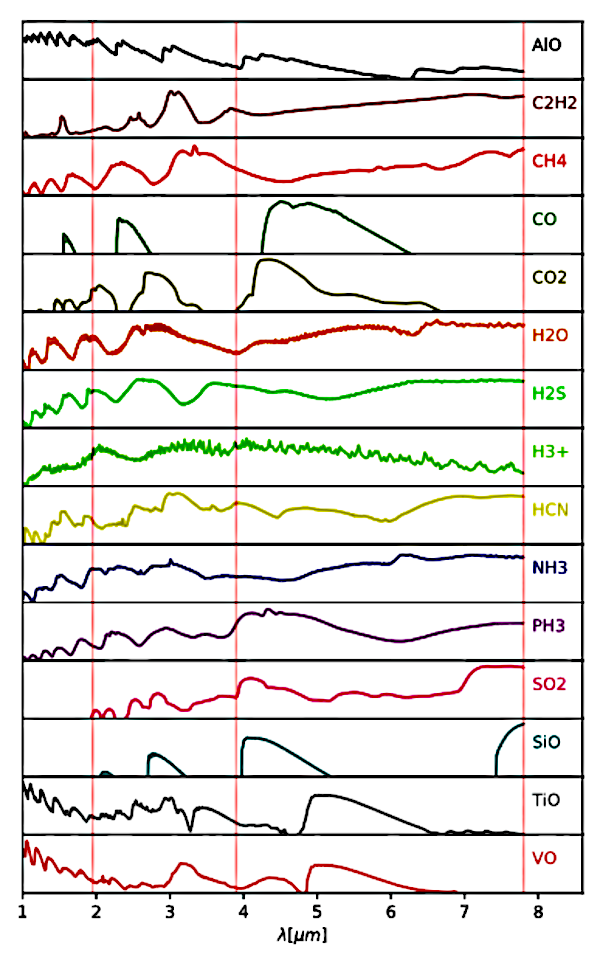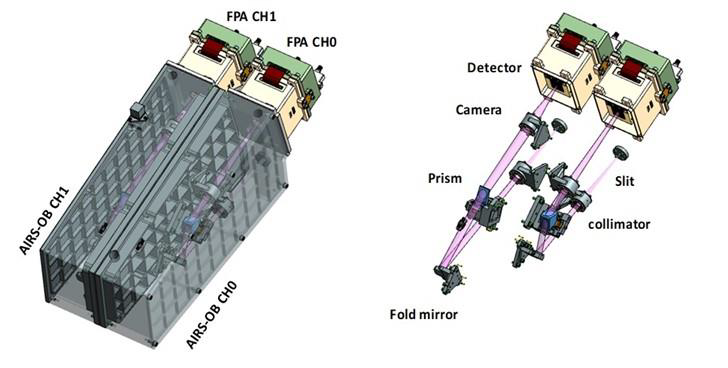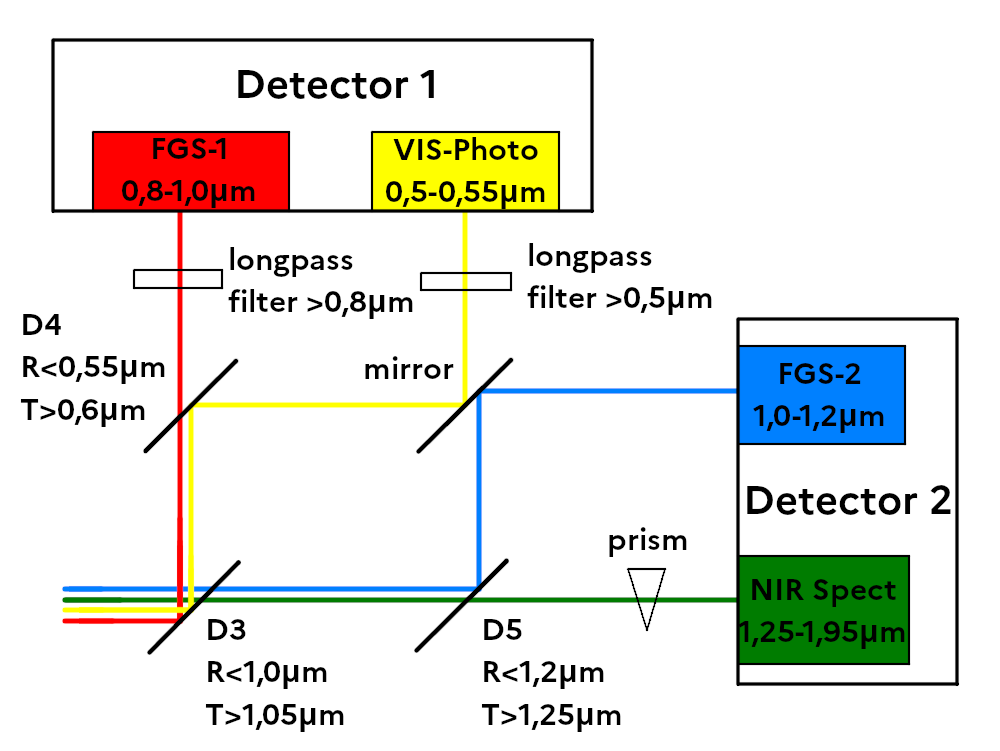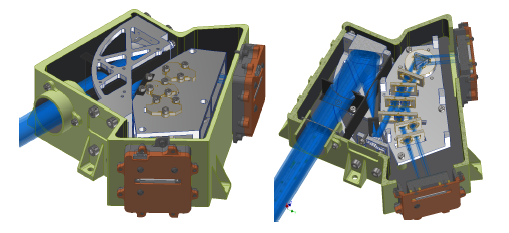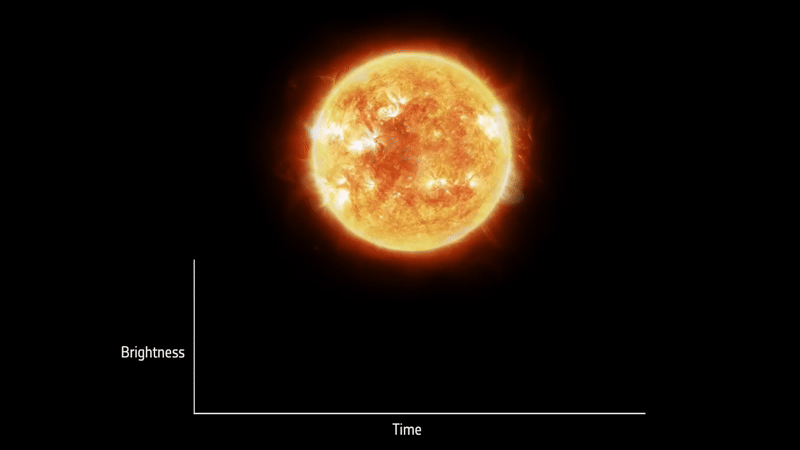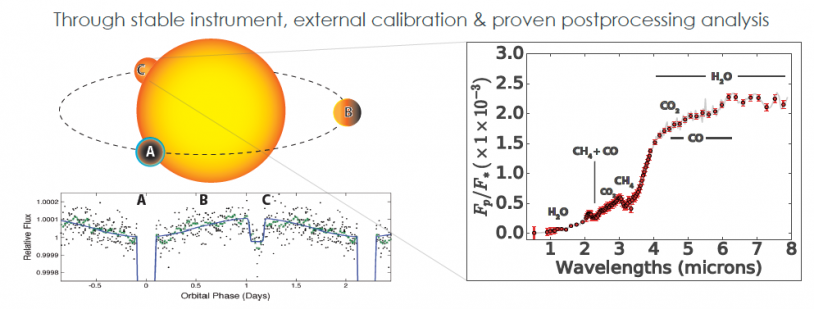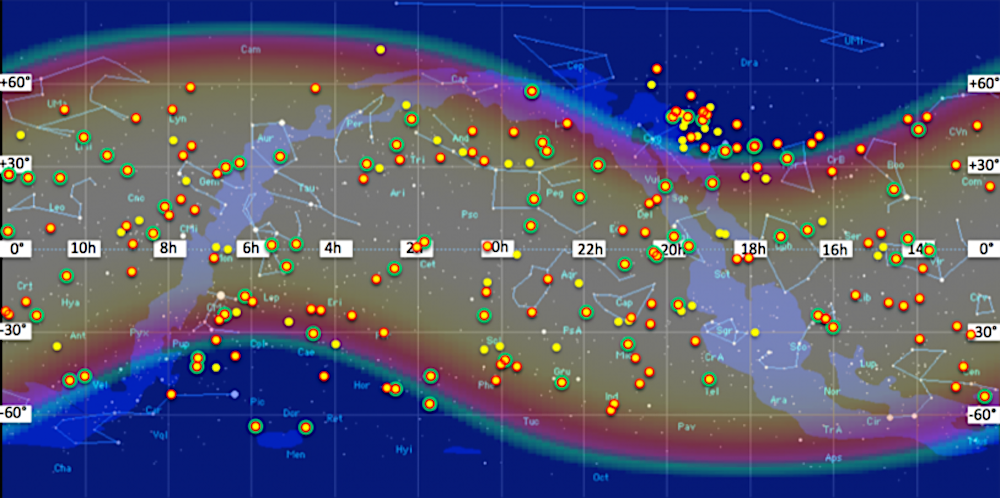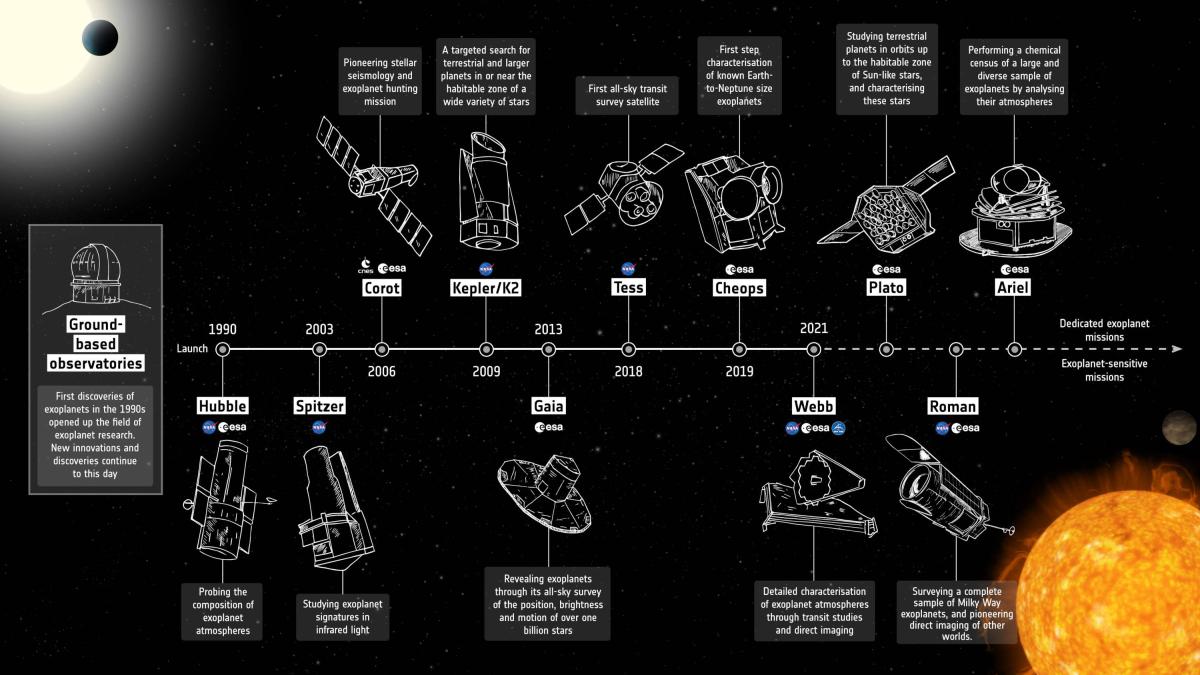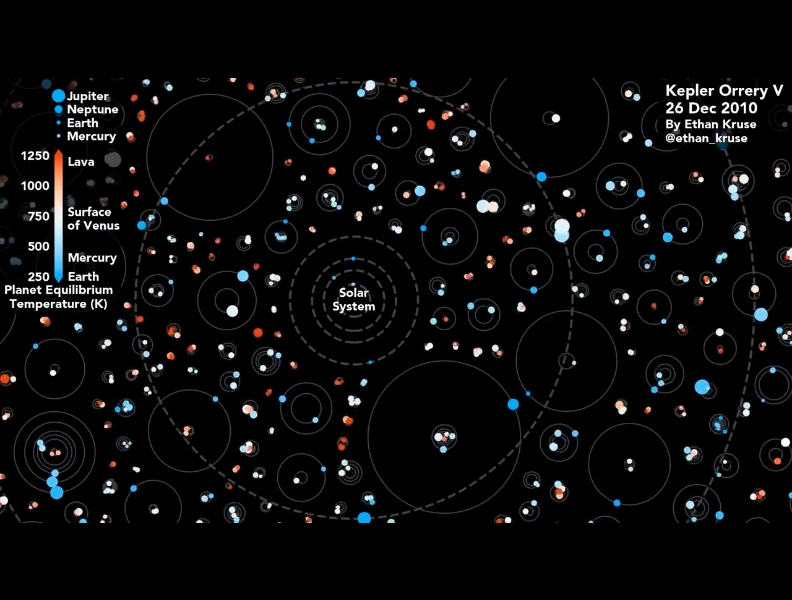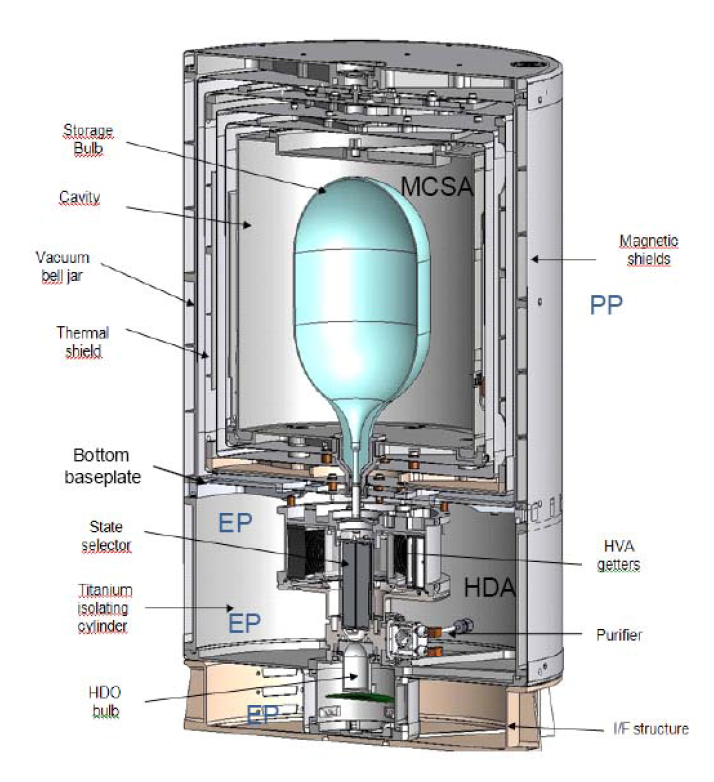1
00:00:00,000 --> 00:00:07,760
Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs.
2
00:00:07,760 --> 00:00:11,800
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
3
00:00:24,080 --> 00:00:26,400
Pour regarder notre maison, la planète,
4
00:00:26,400 --> 00:00:29,400
Il est bien de prendre de la hauteur.
5
00:00:29,400 --> 00:00:31,800
Les premiers satellites d'observation non militaires
6
00:00:31,800 --> 00:00:34,800
datent des années 1970.
7
00:00:34,800 --> 00:00:40,200
Et en 1986, la France lance SPOT, grand frère d'une famille
8
00:00:40,200 --> 00:00:42,960
nombreuse de satellites optiques.
9
00:00:44,880 --> 00:00:49,080
Quoi de mieux qu'un appareil photo à 800 kilomètres d'altitude
10
00:00:49,080 --> 00:00:51,560
pour observer la terre ?
11
00:00:51,560 --> 00:00:54,960
Mais comment ça fonctionne un imageur optique ?
12
00:00:54,960 --> 00:00:56,720
Les satellites imageurs optiques
13
00:00:56,720 --> 00:01:00,960
captent la lumière du Soleil réfléchie par la Terre.
14
00:01:00,960 --> 00:01:02,840
Ils la captent sur une zone définie
15
00:01:02,840 --> 00:01:05,680
plus ou moins large, appelée fauchée.
16
00:01:05,680 --> 00:01:09,120
Plus la fauchée est large, plus la zone observée est grande,
17
00:01:09,120 --> 00:01:12,280
mais plus la résolution spatiale diminue.
18
00:01:12,280 --> 00:01:13,480
La résolution spatiale,
19
00:01:13,480 --> 00:01:15,480
c'est, pour simplifier, l'espacement
20
00:01:15,480 --> 00:01:18,560
entre chaque point de mesure du satellite.
21
00:01:18,560 --> 00:01:22,600
Cette image, voilà ce qu'elle donnerait à une résolution de 10 mètres
22
00:01:22,600 --> 00:01:25,560
comme SPOT ou Sentinel-2 par exemple.
23
00:01:25,560 --> 00:01:29,760
Et voilà avec une résolution 2 fois plus fine de 5 mètres.
24
00:01:29,760 --> 00:01:34,600
Pléiades a une résolution de 50 cm, 10 fois meilleure :
25
00:01:34,600 --> 00:01:37,840
l'image est plus détaillée.
26
00:01:37,840 --> 00:01:39,560
Depuis l’espace, on peut ainsi observer les forêts,
27
00:01:39,560 --> 00:01:41,680
les villes, les champs, les glaciers, l'eau
28
00:01:41,680 --> 00:01:45,080
et même la couleur de l'eau, riche en informations.
29
00:01:45,080 --> 00:01:46,760
Sur ces images satellites, par exemple,
30
00:01:46,760 --> 00:01:50,320
les scientifiques détectent la présence de boue qui contamine l'eau.
31
00:01:50,320 --> 00:01:52,280
Ils peuvent sonner l'alerte.
32
00:01:53,880 --> 00:01:58,240
On peut aussi comparer un paysage avant et après une catastrophe
33
00:01:58,240 --> 00:02:01,920
ou étudier l'évolution d'un paysage sur de longues échelles de temps.
34
00:02:01,920 --> 00:02:04,360
Des satellites optiques sont spécifiquement dédiés à cela,
35
00:02:04,360 --> 00:02:07,800
comme les Sentinel-2 du programme européen Copernicus.
36
00:02:07,800 --> 00:02:09,440
Ces deux satellites photographient
37
00:02:09,440 --> 00:02:12,920
le sol de manière systématique depuis 2015,
38
00:02:12,920 --> 00:02:14,520
ils repassent tous les cinq jours
39
00:02:14,520 --> 00:02:16,840
à la même heure, au dessus du même lieu.
40
00:02:16,840 --> 00:02:19,160
C'est ce qu'on appelle la revisite.
41
00:02:19,160 --> 00:02:20,200
Et ces séries temporelles
42
00:02:20,200 --> 00:02:23,920
sont précieuses pour suivre des phénomènes comme les sécheresses
43
00:02:23,920 --> 00:02:26,360
ou l'évolution des végétations.
44
00:02:26,360 --> 00:02:27,120
Alors, bien sûr,
45
00:02:27,120 --> 00:02:29,840
la résolution de ces images n'atteint pas celle des Pléiades,
46
00:02:29,840 --> 00:02:33,960
car il faudrait alors des capacités de stockage gigantesques
47
00:02:33,960 --> 00:02:38,400
ou des moyens énormes pour transmettre et récupérer ces données au sol.
48
00:02:38,400 --> 00:02:39,920
Pour des images très détaillées,
49
00:02:39,920 --> 00:02:42,840
on peut donc passer commande auprès d'entreprises spécialisées
50
00:02:42,840 --> 00:02:43,640
pour qu'elles braquent
51
00:02:43,640 --> 00:02:46,160
leurs satellites sur une zone bien précise,
52
00:02:46,160 --> 00:02:49,880
pour cartographier la végétation d'une ville, par exemple.
53
00:02:49,880 --> 00:02:53,040
Voici une photo du festival Hellfest à Clisson,
54
00:02:53,040 --> 00:02:58,160
prise par le satellite Pléiades Neo d'Airbus. Bluffant, non ?
55
00:02:58,160 --> 00:03:02,640
Sa résolution est de 30 cm pour une fauchée de 14 kilomètres.
56
00:03:03,720 --> 00:03:05,200
Et là, c'est la Guyane.
57
00:03:05,200 --> 00:03:08,400
Eh oui, ben voilà, c'est ça le problème.
58
00:03:08,400 --> 00:03:14,200
Les ondes de la lumière visible ne traversent pas les nuages.
59
00:03:14,280 --> 00:03:17,640
On utilise dans ce cas des satellites imageurs radar
60
00:03:17,640 --> 00:03:21,120
pour continuer à regarder notre maison.
61
00:03:24,840 --> 00:03:29,040
Séismes, inondations, glissements de terrain, explosions d'usines.
62
00:03:29,040 --> 00:03:30,360
En cas de catastrophe,
63
00:03:30,360 --> 00:03:34,040
l'imagerie spatiale est un outil précieux pour les pouvoirs publics.
64
00:03:34,040 --> 00:03:34,920
Le CNES et l'ESA,
65
00:03:34,920 --> 00:03:37,120
les agences spatiales française et européenne,
66
00:03:37,120 --> 00:03:38,360
ont créé en l'an 2000
67
00:03:38,360 --> 00:03:41,520
la Charte Internationale Espace et Catastrophes Majeures.
68
00:03:41,520 --> 00:03:43,440
C'est une sorte de contrat
69
00:03:43,440 --> 00:03:46,920
où les pays signataires s'engagent à mobiliser leurs satellites
70
00:03:46,920 --> 00:03:48,520
le plus rapidement possible,
71
00:03:48,520 --> 00:03:52,440
pour faire des photographies des zones touchées par la catastrophe.
72
00:03:52,440 --> 00:03:53,400
Ainsi, en quelques heures,
73
00:03:53,400 --> 00:03:56,440
les secours peuvent obtenir des images optiques
74
00:03:56,440 --> 00:03:58,440
ou radar des zones touchées.
75
00:03:58,440 --> 00:04:02,040
Et même mieux, ils peuvent obtenir des cartes légendées.
76
00:04:02,040 --> 00:04:03,760
Elles sont fabriquées ici
77
00:04:03,760 --> 00:04:04,520
au SERTIT,
78
00:04:04,520 --> 00:04:07,960
le Service régional de traitement d'images et de télédétection.
79
00:04:07,960 --> 00:04:09,240
C'est à Strasbourg.
80
00:04:09,240 --> 00:04:11,320
C'est un service de cartographie rapide,
81
00:04:11,320 --> 00:04:14,880
un service d'urgence avec des experts mobilisables
82
00:04:14,880 --> 00:04:16,880
tous les jours, 24 heures sur 24
83
00:04:16,880 --> 00:04:19,520
et capables de traiter les images satellites
84
00:04:19,520 --> 00:04:23,120
pour en faire des cartes adaptées, utiles et adaptées
85
00:04:23,120 --> 00:04:25,040
aux besoins des secours sur place.
86
00:04:25,040 --> 00:04:26,640
Sur le terrain, en effet,
87
00:04:26,640 --> 00:04:28,840
les routes, les ponts peuvent être coupés,
88
00:04:28,840 --> 00:04:30,240
les télécommunications aussi.
89
00:04:30,240 --> 00:04:33,960
Parfois même, il n'y a plus du tout d'électricité...
90
00:04:33,960 --> 00:04:36,600
Grâce aux satellites, depuis l'espace, on peut estimer les dégâts,
91
00:04:36,600 --> 00:04:40,320
savoir où envoyer les secours, l'eau ou encore la nourriture.
92
00:04:40,320 --> 00:04:42,480
Depuis l'an 2000, la charte a été activée
93
00:04:42,480 --> 00:04:46,040
plus de 820 fois dans plus de 130 pays du monde.