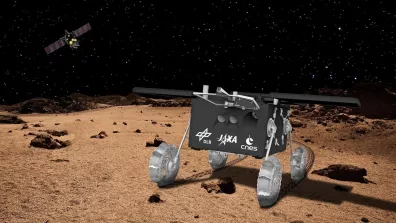Constellation Optique 3D (CO3D) est, comme son nom l’indique, un programme d’observation de la Terre fondé sur quatre petits satellites optiques. Avec ceci d’inédit : les satellites fonctionnent deux par deux, chaque paire photographiant simultanément la même zone sous des angles légèrement différents. Les photos ainsi prises sont assemblés pour créer une image en 3 dimensions, exactement comme le fait notre cerveau à partir des images produites par nos deux yeux.
« L’objectif de CO3D est de cartographier toutes les terres émergées de notre planète, explique Philippe Maisongrande, expert Surfaces Continentales au CNES, en trois dimensions. Nous obtiendrons des cartes en relief du sol, mais aussi de tout ce qui s’y trouve, bâtiments, forêts, cultures, infrastructures... »
Et les intérêts sont multiples, notamment pour notre planète ! Delphine Leroux, responsable thématique Cycle de l’eau au CNES, s’enthousiasme : « On pourra reconstruire précisément le relief d’un bassin versant. On verra les chemins qu’empruntent les eaux de pluie pour rejoindre leur cours d’eau et la modification de ces chemins au cours du temps. On pourra ainsi mieux anticiper les risques d’inondation par exemple. »
Au fil des eaux terrestres
Les glaciologues également s’intéressent à la mission CO3D, d’ores et déjà intégrée dans le Pléiades Glacier Observatory. Ce programme surveille, depuis presque 10 ans, 140 glaciers à travers le monde, de l‘Argentine à l’Himalaya, grâce aux images satellites. Celles produites par les satellites Pléiades et donc aussi, bientôt, celles de CO3D. « Grâce aux données CO3D, nous pourrons voir avec une plus grande précision et une plus grande régularité dans le temps, l’évolution des glaciers, leur fonte, leur déplacement… précise Delphine. Les volumes d’eau qu’ils contiennent seront également plus justement estimés. »
Les satellites fourniront des images captées dans différentes longueurs d’ondes, celles de la lumière visible, mais aussi celles dans le proche infrarouge. Cette bande spectrale proche infrarouge permet de distinguer clairement le règne végétal. « CO3D sera un atout précieux pour surveiller la végétation, cultures ou forêts, poursuit Philippe Maisongrande. Grâce à la 3D, nous pourrons par exemple obtenir une estimation de la hauteur, et donc du volume, des arbres. Information utile pour estimer leur capacité à stocker le CO2 que nos avions ou nos voitures relâchent dans l’atmosphère. »

Rappelons également que les satellites CO3D sont avant tout de gros appareils photos, équipés de capteurs offrant une résolution de 50 cm. En clair, leurs images révèleront des détails comme des arbres isolés ou des haies dans un paysage agricole, éléments importants dans la lutte contre le déclin de la biodiversité.
Au service des collectivités
CO3D est une mission conçue, développée et financée par le CNES (40 %) et Airbus Defense and Space (60 %), qui en assurera officiellement l’exploitation commerciale après une phase de démonstration de 18 mois. Ce partenariat assure l’accès aux images à des coûts très avantageux pour de nombreuses structures nationales comme le ministère des Armées (lire encadré), la communauté scientifique, les collectivités territoriales ou la sécurité civile. De plus, chaque année, CO3D capturera 600 000 km2 de surface, que le CNES mettra à disposition des partenaires institutionnels français, gratuitement.
Un satellite dual
Les données acquises par la mission CO3D visent à répondre à des besoins tant civils que militaires. On parle de « dualité ». En matière de défense, les données CO3D aideront par exemple à préparer les missions aériennes à basse altitude ainsi que les déploiements de véhicules et de troupes sur divers terrains.
Prévention des inondations, suivi minier, agriculture de précision… La liste des usages possibles est longue. Pour les collectivités territoriales notamment, qui pourront s’appuyer sur la vision en 3D de leurs territoires pour améliorer leur aménagement. Un exemple ? L’optimisation des trames vertes et bleues, ces « couloirs écologiques » naturels, terrestres ou aquatiques, qu’empruntent les animaux pour se nourrir, se reproduire. Préserver ces réseaux aide ainsi à enrayer la perte de la biodiversité.
L’aménagement urbain ne sera pas en reste. « Les images de CO3D permettront de créer des modèles numériques très détaillés des villes, explique Philippe Maisongrande. La nature des sols, l’organisation de la ville, la place et le type de végétation… Ces modèles pourront être enrichis d’informations diverses, venant d’autres sources, sur les matériaux ou la température des rues, des bâtiments… Je pense notamment aux donnés du satellite franco-indien Trishna qui mesurera précisément la température de surface, partout sur la planète. »
Ces modèles serviront à faire de la climatologie à l’échelle des villes voire des quartiers, et lutter contre les îlots de chaleur urbains (zones d’une ville où la température est plus élevée). Les municipalités pourront aussi simuler la dynamique des vents pour améliorer la qualité de l’air en ville, la propagation des nuisances sonores ou encore la performance énergétique des bâtiments.
De la terre à la mer
En 3 ans, CO3D doit produire la carte 3D de 125 millions de km2 de surfaces terrestres. Terrestres et même un peu plus ! Car la mission scrutera tous les littoraux, jusqu’aux premiers mètres de terres immergées que les instruments pourront en effet photographier. « Quand la profondeur n’est pas trop importante, » précise toutefois Lionel Perret, chef de projet de la mission au CNES.
Et l’enjeu est de taille. Le trait de côte, la limite entre la terre et la mer, recule. Ce phénomène s’aggrave avec le changement climatique. Selon le Cerema (Centre d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), en 2028, environ un millier de bâtiments en France pourraient être impactés, pour un coût de 240 millions d’euros – qui correspond à la valeur des bâtiments. À l’horizon 2050, ce sont plus de 5 000 logements qui risquent d’être affectés.
« De nombreux projets utilisant les données CO3D se montent autour de cette problématique, confirme Jean-Baptiste Henry, responsable du programme aval de la mission. Dans le civil mais aussi avec les armées, intéressées par la précision des données au niveau des littoraux. Pour le développement d’opérations amphibie par exemple. »
En effet, CO3D est un satellite dual, c’est-à-dire répondant à la fois à des besoins civils et militaires. « Des projets d’exploitation des données sont déjà en cours, détaille Jean-Baptiste Henry. Comme ce projet mené avec le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) qui vise à mettre au point une méthode de modélisation continue du littoral grâce à la capacité de CO3D à accéder à la fois à la bathymétrie jusqu’à 10 ou 15 m de profondeur, et à la topographie. »
Car c’est aussi le rôle du CNES de favoriser le développement de services ou de technologies basées sur les données de la mission. Et faire en sorte qu’ils trouvent leurs usagers et leurs intérêts. Notamment pour nous aider à nous adapter au changement climatique.
250 000 trilogies du Seigneur des Anneaux
CO3D doit réaliser l’image tridimensionnelle de 125 millions de km2 de surfaces, soit 6 000 Téraoctets de données. Soit l’équivalent de… 250 000 trilogies du Seigneur des Anneaux en haute définition (versions longues, bien sûr !). Pour répondre à cet enjeu, le CNES a développé des algorithmes spécifiques pour traiter les images et produire la 3D de manière automatique et massive dans le cloud. Enfin, notez que pour optimiser les prises d’images, CO3D intègre un bulletin météo actualisé, tous les quarts d’heure. Pas de photo inutile si des nuages sont annoncés et évités !