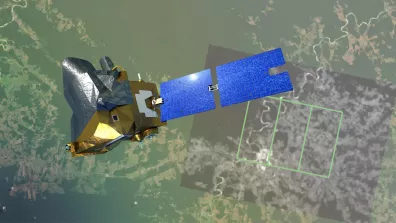« Je suis spécialiste des applications spatiales pour la connaissance scientifique et l’appui aux décisions publiques », résume Frédéric Huynh, directeur de l’infrastructure de recherche Data Terra. Formé à l’École Centrale en 1992, cet ingénieur se tourne rapidement vers les données spatiales pour scruter les impacts de l’évolution du climat, au service de l’adaptation des territoires.
En poste à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), il passe cinq ans en Guyane, où il implante et dirige un laboratoire de recherche spécialisé en télédétection spatiale. C’est là que sa route croise celle du CNES. « Je me suis occupé d’applications pour le suivi de l’environnement et des écosystèmes côtiers et forestiers », précise-t-il. Un exemple pour illustrer l’apport de la donnée spatiale : son utilisation massive par le Brésil pour combattre la déforestation en Amazonie. Il réalise aussi des études d’impact des activités du site d’Ariane 5 sur l’environnement : « Il s’agissait de caractériser la vulnérabilité de tous les milieux qui allaient subir des perturbations liées à son exploitation. » Avec son équipe, il évalue les dynamiques côtières et l’envasement des côtes, « très impactant pour le Centre spatial guyanais ». Le laboratoire dans lequel il travaille met au point la première méthodologie utilisant la donnée spatiale pour mesurer la quantité de carbone stockée par un système forestier tropical.
En 1999, Frédéric Huynh est nommé chargé de mission pour les affaires spatiales de l’IRD. Aux côtés du CNES, il participe au déploiement du réseau Terre et Espace pour développer des projets « d’observation spatiale de la Terre pour l’agriculture, les ressources en eau et l’océan ». En ligne de mire : la préparation des équipes françaises au programme Copernicus. En 2005, il pilote la mise en place de SEAS Guyane, une station offrant une capacité de réception en temps réel des données des satellites SPOT et des radars. Un atout majeur pour le suivi du trait de côte, de l’orpaillage et des écosystèmes amazoniens. « Tous ces projets menés en collaboration avec le CNES ont contribué à rendre plus compréhensibles l’utilisation et l’apport de l’imagerie spatiale sur le terrain », observe-t-il.
Prendre le pouls du système Terre
À la tête de Data Terra depuis 2017, Frédéric Huynh organise un accès unifié à toutes les données issues de l’espace et récoltées in situ, produites par les infrastructures de recherche, laboratoires et observatoires. « Data Terra les stocke, les distribue et développe des outils pour faciliter leur traitement », détaille-t-il. Objectif : enrichir la connaissance des interactions entre la Terre, la biodiversité, l’océan et les sciences de l’eau (hydrosciences), soutenir les politiques publiques en France et en Europe, et affronter les grands défis climatiques à l’échelle mondiale.
Au total, 34 organismes de recherche et universités, dont le CNES, le CNRS et l’IRD, soutiennent Data Terra pour construire une infrastructure souveraine de données scientifiques. Un sujet stratégique, à l’heure où Donald Trump s’attaque à la science. « Certaines données perdues le sont de façon définitive puisqu’on ne reverra plus les phénomènes observés, alerte-t-il. Pour accompagner des transitions durables, ces données et l’expertise associée doivent être partagées avec la société et les acteurs publics. « C’est une responsabilité de citoyen et de scientifique, estime Frédéric Huynh. En associant ces informations, Data Terra constitue un système d’observation permanent qui prend le pouls du système Terre. »
-
Découvrez le nouveau CNESMAG !
Ce portrait est la version longue d'un article paru dans CNESMAG n°98.

À lire aussi
-
Notre dossier : l'espace au chevet de la Terre
Climat, océans, biodiversité, forêts : les satellites d’observation fournissent sur notre planète de précieuses données. Les connaissances acquises par leur biais nous permettent de mieux comprendre, et ainsi de mieux protéger la Terre. À travers ce dossier, découvrez en plus sur nos sentinelles de l'espace !