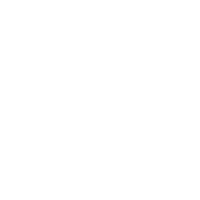MicroCarb a rejoint l'espace et son orbite dans la nuit du 25 au 26 juillet ! Ce microsatellite, développé par le CNES, a pour but de cartographier les sources et puits de dioxyde de carbone (CO2), le plus important gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, à l’aide d’un spectromètre à réseau dispersif compact de 80 kg. Mais de quoi se compose exactement ce satellite ? Responsable de l'instrument de MicroCarb au CNES, Élodie Cansot fait les présentations.
« Une fois assemblé au Royaume-Uni, le satellite MicroCarb a été stocké plusieurs mois en salle blanche au CNES à Toulouse. C’est là qu’a été prise la photo ci-dessous. La salle blanche est le lieu où on stocke les satellites avant leur lancement. À l'intérieur, l’air est filtré selon des normes précises pour limiter au maximum la présence de particules, car les instruments optiques sont très sensibles aux particules comme les poussières. »

« Sur la photo, on peut voir l’instrument sur la partie supérieure (le plus gros parallélépipède) et la plateforme dessous. L’ensemble est recouvert d’une couverture isolante dorée, sorte de couverture de survie. »
De quoi est constitué un satellite ?
Quelle que soit leur mission, tous les satellites sont composés de deux parties : la plateforme et la charge utile. La première fournit les ressources nécessaires au satellite pour fonctionner. Elle réunit des éléments appelés servitudes, qui assurent la navigation, la propulsion et les communications avec la Terre. La charge utile, elle, comprend tous les instruments, qui représentent un peu les passagers à bord. Dans le cas de MicroCarb, il n’y en a qu’un seul : son spectromètre infrarouge.
L’instrument

« À l’intérieur de l’instrument, on trouve un système de pointage et de calibration équipé d’un miroir, un télescope et un spectromètre. En entrée de l’instrument, le miroir optique dirigé vers la Terre sert à capter la lumière : il est protégé derrière la bâche grise en forme de rectangle allongé pour éviter tout dépôt de poussière, et ce, même si on se situe en salle blanche ! Sur la face non visible de l’instrument (à gauche sur la tranche), on trouve un radiateur : il maintient la température du boîtier de contrôle – la tour de contrôle des équipements électroniques – entre -7°C et 25°C. »
La plateforme

« Sur la partie inférieure, on observe un panneau de la plateforme Myriade développée par le CNES. Les tubes gris et rouge sont des capots qui sont démontés juste avant le lancement du satellite. Derrière, on trouve deux antennes radio : celles-ci permettent aux équipes au sol de communiquer avec le satellite. L’antenne bande S (capot gris) sert à envoyer les instructions au satellite et transmettre ses paramètres de suivi, tandis que celle en bande X (capot rouge) transmet les mesures sciences de l’instrument. Enfin, le rectangle gris sur le satellite (le plus petit des deux) est un radiateur qui permet de refroidir certains équipements du satellite. »
Un générateur (panneau) solaire a été ajouté par la suite au satellite, également en salle blanche à Toulouse. Monté en position ouverte, il a ensuite été replié et connecté au système de pyros, le dispositif pyrotechnique permettant son déploiement une fois en orbite.
À voir aussi
Le métier de responsable instrument au CNES
Parmi l’ensemble des personnes impliquées dans la conception d’un satellite, le ou la responsable instrument a un rôle clé : développer un instrument qui réponde aux besoins de la mission. On peut les voir comme un(e) maître d'œuvre sur un chantier de construction.
« Pour MicroCarb, le challenge était de faire un instrument petit et performant, raconte Élodie Cansot. Nous nous sommes tout de suite dirigés vers un concept novateur. » En pratique, Élodie Cansot et son équipe ont soumis leur idée et leurs spécifications à un industriel qui s’est chargé ensuite de développer l’instrument. « Je me suis assurée tout au long du développement que l’instrument réponde aux besoins de la mission et qu’il s’interface bien avec le satellite, ajoute-t-elle. J’ai fourni au responsable performances mission l’ensemble des caractérisations nécessaires pour spécifier les chaînes de traitement et vérifier la performance mission. »
Une fois l’instrument intégré et qualifié, il est livré au satellite et le responsable instrument participe aux activités d’intégration et de qualification du satellite. Il ou elle s’assure enfin du bon fonctionnement de l’instrument placé en orbite.
« J’ai une formation d’ingénieure généraliste, c’est important pour ce type de métier, commente Élodie Cansot. Mais ce poste requiert aussi un bon esprit d’équipe, des qualités de manager, un esprit critique et de synthèse et une bonne gestion du stress ! »
Pour aller plus loin
-
Comment les satellites aident à comprendre la « machine carbone »
Le microsatellite MicroCarb apporte à la communauté scientifique mondiale un nouvel outil spatial de haute précision pour mesurer les concentrations de CO2 dans l’atmosphère.

-
MicroCarb, une mission novatrice en orbite pour scruter le CO2
MicroCarb embarque un détecteur innovant développé grâce au soutien du CNES. La mission devrait démontrer sa robustesse pour, à l’avenir, doter l’Europe d’un satellite sentinelle du CO2.